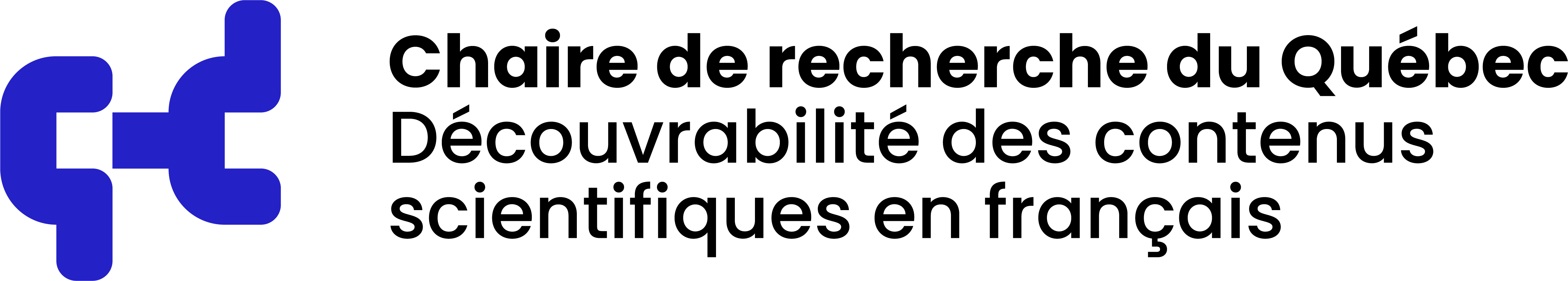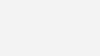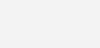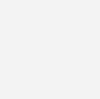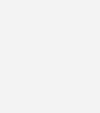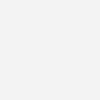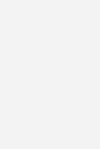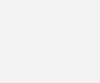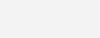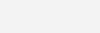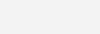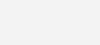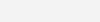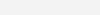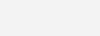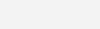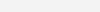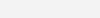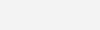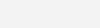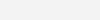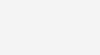56%
D'articles
6 M+ Contenus analysés
Lorem ipsum dolor sit amet. Aut autem porro rem tempore sapiente eos sunt repudiandae
Qui sommes-nous ?
La Chaire
Créée par le Fonds de recherche du Québec au printemps 2024, la Chaire de recherche sur la découvrabilité des contenus scientifiques en français s’intéresse à l’accès, la diffusion et l’usage des contenus scientifiques en français.
La Chaire est investie d’une double mission :
- analyser l’usage du français en recherche au Québec, au Canada et ailleurs dans la francophonie ;
- étudier les voies potentielles d’accroissement de la production et de la découvrabilité des contenus scientifiques en français.
Bénéficiant d’un financement de 1,5 million $ pour les cinq prochaines années, elle vise une meilleure compréhension des pratiques de publication de la communauté scientifique et des outils technologiques permettant aux contenus scientifiques d’être repérables, accessibles et mobilisés.
Plus précisément, la Chaire proposera des solutions concrètes pour infléchir le recul de l’usage du français en recherche, ainsi que pour bonifier significativement les capacités de découverte des principales plateformes de diffusion de contenus en français utilisées au Québec.
Les cotitulaires de cette Chaire sont Vincent Larivière, professeur à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal, titulaire de la Chaire UNESCO sur la science ouverte et directeur scientifique d’Érudit, et Marie-Jean Meurs, professeure en informatique à l’Université du Québec à Montréal, directrice scientifique sortante de Calcul Québec et vice-présidente du Conseil des chercheurs de l’Alliance de recherche numérique du Canada.
La découvrabilité
Le concept de discoverability, en anglais, a plus de 150 ans. Son emploi est cependant demeuré relativement limité jusqu’à ce que l’essor du numérique, dans les années 1990, lui donne sa signification actuelle : le concept naît alors de la difficulté à découvrir certains contenus dans un contexte de saturation de l’environnement numérique.
Dans l’univers francophone, la réflexion émerge plus tardivement, à l’initiative des industries culturelles et des instances gouvernementales qui s’inquiètent du déséquilibre croissant entre les productions anglo-saxonnes et celles dans des langues autres que l’anglais sur les grandes plateformes numériques de découverte de contenu.
À l’issue de la Mission franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones, chapeautée par les ministères de la Culture de la France et du Québec en 2020, différentes définitions ont convergé vers la suivante :
« La découvrabilité d’un contenu dans l’environnement numérique désigne sa disponibilité en ligne et sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d’autres contenus, notamment par une personne qui n’en faisait pas précisément la recherche. »
— Le ministère de la Culture et des Communications (Québec) et le ministère de la Culture (France)
Pour faire suite aux discussions dans le champ culturel, les organismes de financement et de soutien à la recherche ont récemment investi dans la recherche associée à la découvrabilité des contenus en science. Celle-ci est perçue comme un moyen de soutenir et de renforcer l’usage du français et celui du multilinguisme.
Principes et valeurs
Science ouverte
La science ouverte est considérée par bon nombre d’actrices et d’acteurs de l’écosystème de la recherche comme étant la clé vers une science plus transparente, inclusive, fiable et participative, dont les impacts sociaux et économiques sont maximisés.
À la Chaire, nous souhaitons stimuler l’adoption de pratiques permettant de rendre la science plus accessible, efficace et de meilleure qualité. C’est pourquoi nous pensons la découvrabilité dans un contexte de science ouverte, tout en nous appuyant sur les meilleures pratiques disponibles (libre accès, données ouvertes, etc.).
Voir la Déclaration de Barcelone sur l’information de recherche ouverte et l’introduction à la Recommandation de l’UNESCO sur une science ouverte.
Multilinguisme
La production et la diffusion de contenus scientifiques en français, et dans d’autres langues que l’anglais, apportent une contribution essentielle à la bibliodiversité.
Conformément à l’Initiative d’Helsinki sur le multilinguisme dans la communication savante et à l’Appel de Jussieu pour la science ouverte et la bibliodiversité, nous pensons que le multilinguisme garantit l’ancrage social des savoirs scientifiques et la bibliodiversité, en plus de permettre l’expression de perspectives spécifiques à certaines langues ou cultures.
Évaluation équitable de la recherche
En s’appuyant sur des critères bibliométriques (nombre d’articles dans des revues à facteur d’impact élevé, etc.), les règles d’évaluation du travail scientifique favorisent massivement la publication en anglais.
À la Chaire, nous nous inscrivons en phase avec la Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche et l’Accord sur la réforme de l’évaluation de la recherche de la Coalition pour l’avancement de l’évaluation de la recherche, qui déplorent les effets délétères de l’évaluation quantitative de la recherche sur la bibliodiversité, notamment sur la diversité linguistique.
Équipe de la Chaire
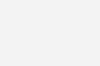
Vincent Larivière
Titulaire - Professeur à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l'Université de Montréal (UdeM)
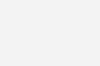
Marie-Jean Meurs
Titulaire - Professeure en informatique, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Membres
Professeur en communication sociale et publique
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Directeur de recherche au Département de défense et sécurité
Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA)
Postdoctorante à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information et conseillère de recherche
Université de Montréal (UdeM) et Érudit
Directeur de la recherche et du développement
Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM)
Professeure à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
Université de Montréal (UdeM)
PhD en sciences de l'information, Consultant principal en recherche, chercheur en visite
Université de Montréal (UdeM)
Directeur général
Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML)
Professeure au Département de mathématiques et de génie industriel
Polytechnique Montréal
Candidate au Doctorat en Science, Technologie et Société (STS)
Université du Québec à Montréal (UQAM) / CIRST
Posdoctorant à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information
Université de Montréal (UdeM)
Professeur au Département d’études littéraires
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Professeure à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
Université de Montréal (UdeM)
Personne étudiante au doctorat en informatique cognitive
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Professeur au Département de lettres et communication sociale
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Professeure au Département des arts, langues et littératures
Université de Sherbrooke (UdeS)
Candidate à la maîtrise en Sciences de l'Information
Université de Montréal (UdeM)
David Montminy
Doctorant en philosophie
Université de Montréal (UdeM)
Professeur en communication sociale et publique
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Professeur au Département de sociologie et d’anthropologie
Université Concordia
Membres
Nos membres possèdent des expertises dans différents domaines. Ces spécialistes en enseignement et en recherche travaillent à mieux saisir les enjeux de la découvrabilité des contenus scientifiques en français.

Vincent Larivière
Professeur à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information Université de Montréal (UdeM)
Professeur au Département de lettres et communication sociale
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Directeur général
Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML)
Professeur au Département de sociologie et d’anthropologie
Université Concordia
Professeur au Département d’études littéraires
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Postdoctorante à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information et conseillère de recherche
Université de Montréal (UdeM) et Érudit
PhD en sciences de l'information, Consultant principal en recherche, chercheur en visite
Université de Montréal (UdeM)
Professeure à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
Université de Montréal (UdeM)
Professeure à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
Université de Montréal (UdeM)
Professeure au Département des arts, langues et littératures
Université de Sherbrooke (UdeS)
Professeure au Département de mathématiques et de génie industriel
Polytechnique Montréal
Professeur en communication sociale et publique
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Professeur en communication sociale et publique
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Directeur de recherche au Département de défense et sécurité
Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA)
Directeur de la recherche et du développement
Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM)
Personne étudiante au doctorat en informatique cognitive
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Posdoctorant à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information
Université de Montréal (UdeM)
David Montminy
Doctorant en philosophie
Université de Montréal (UdeM)
Candidate à la maîtrise en Sciences de l'Information
Université de Montréal (UdeM)
Candidate au Doctorat en Science, Technologie et Société (STS)
Université du Québec à Montréal (UQAM) / CIRST
Recherche
Soutien à la recherche académique aux États-Unis
La Chaire de recherche du Québec sur la découvrabilité des contenus scientifiques en français exprime son soutien sans réserve à la communauté académique états-unienne, actuellement confrontée à la censure et à des coupes budgétaires massives qui précarisent le milieu et menacent la liberté académique. La situation est préoccupante et nous engage à réaffirmer l’importance de garantir un environnement de recherche ouvert, sûr et inclusif, préservé des pressions extérieures, idéologiques ou politiques.
La chaire UNESCO sur la science ouverte tient à jour une page web présentant une liste non exhaustive d’initiatives qui documentent les événements et retracent le travail essentiel des archivistes et des bibliothécaires, qui s’emploient à préserver les informations supprimées ou censurées par les autorités gouvernementales américaines. La page répertorie une liste actualisée de publications médiatiques et scientifiques, produites par les membres de la Chaire UNESCO sur la science ouverte, en lien avec ces enjeux.
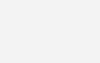
Science le grand effacement
Infographie résumant la conférence de Vincent Larivière, présentée au cœur des sciences.
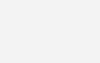
Debout pour la science!
La chaire adhère au mouvement international "Stand up for science".
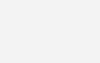
Déclaration pour défendre la recherche
contre la censure du gouvernement des États-Unis
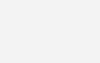
Les conséquences scientifiques du démantèlement de l’État américain
Lettre parue dans Le Devoir, par Vincent Larivière
Axes de recherche
Axe 1
Portrait de l'usage du français
La production d’un portrait de l’usage du français dans le milieu de la recherche, de la médiation scientifique et d’autres formes de mobilisation des connaissances au Québec
Axe 2
Évaluation de l'accessibilité des contenus
La réalisation d’un bilan de l’accessibilité des contenus scientifiques publiés en français au Québec et dans le monde
Axe 3
Analyse des possibilités d'amélioration de la découvrabilité par l'IA
Une analyse des possibilités d’amélioration de la découvrabilité offertes par les algorithmes à l'état de l'art pour la recherche d'information et la recommandation
Portrait de l’usage du français dans l’écosystème de production et diffusion des contenus scientifiques en français au Québec
- Identifier et circonscrire les dynamiques à l’œuvre dans l’écosystème de la recherche scientifique (au Québec et ailleurs dans le monde) en ce qui concerne la place et l’usage du français comme langue de travail, de communication, de diffusion et de vulgarisation.
- Évaluer les proportions de production et de découvrabilité des contenus scientifiques en français au Québec, en fonction d’indicateurs clés.
État de l’accessibilité des contenus scientifiques publiés en français
- Identifier les facteurs positivement associés à la découvrabilité, ainsi que les barrières à l’utilisation des contenus, laquelle est mesurable en termes de téléchargement et de citation.
- Analyser la couverture des revues scientifiques et des autres types de publication dans les principaux index de citations et bases de données pour la recherche, en fonction de leur langue.
- Quantifier la relation entre la langue de diffusion, le lieu de publication et le nombre de citations des contenus scientifiques, en mettant l’accent sur les différents publics qui font usage des travaux.
- Documenter les comportements informationnels des chercheuses et chercheurs en étudiant la langue des références des documents cités dans leurs travaux.
Analyse des possibilités d’accroissement de la découvrabilité offertes par divers algorithmes de recherche et de recommandation
- Étudier les choix algorithmiques des plateformes de découverte de contenu, ainsi que leur influence sur la découvrabilité des contenus scientifiques en français, en mettant l’accent sur la recherche d’information et la recommandation de contenu.
- Concevoir des pistes efficaces d’amélioration de la découvrabilité des contenus scientifiques en français.
Projets de recherche
En 2024, l’équipe de Vincent Larivière, formée de 13 chercheuses et chercheurs issus de milieux linguistiques et culturels différents, a entrepris l’évaluation de la qualité des données d’OpenAlex, la base de données ouverte la plus inclusive du monde. Lancée en 2022, la plateforme a été accueillie avec enthousiasme par les communautés de recherche. Promettant des informations de recherche complètes, inclusives et libres, elle a été considérée comme une solution de rechange aux bases de données payantes et fermées (Web of Science, Scopus). Toutefois, la qualité des métadonnées d’OpenAlex devait encore être mesurée.
Dans le cadre d’une première étude, l’équipe a évalué l’exhaustivité et la précision des métadonnées linguistiques de la plateforme en vérifiant manuellement les langues d’un échantillon de 6 836 articles.
La recherche a démontré que près de 15 % des articles ne sont pas rédigés dans la langue déclarée par la plateforme. Ces inexactitudes conduiraient à une surestimation de la place de l’anglais et à une sous-estimation de celle d’autres langues comme le français, ce qui laisse croire que la diversité linguistique de la plateforme est encore plus grande qu’annoncé.
Le concept de découvrabilité suscite un intérêt croissant en raison des transformations engendrées par la numérisation et la plateformisation des milieux culturels et scientifiques. Pourtant, rares sont les travaux qui l’abordent sous un angle théorique. En examinant les dynamiques de découverte des productions éditoriales en ligne, ma thèse propose une conceptualisation approfondie de la découvrabilité. J’y soutiens qu’elle est un phénomène global (touchant toutes les composantes d’un milieu), transversal (couvrant divers aspects interdépendants) et structurant (pouvant transformer les pratiques et usages). Pour analyser cette dynamique, j’ai développé le modèle de l’«écosystème du livre», qui examine la découvrabilité sous trois dimensions interconnectées: les pressions régulatrices (les contraintes économiques, technologiques, politiques, socioculturelles façonnant le monde du livre); les cycles de vie du livre (les processus de production, distribution et consommation/réception); et la translation (une forme émergente de diffusion articulant la curation, la valorisation et la prescription des contenus). La présente communication explore la possibilité de transposer ce modèle au milieu universitaire, en tenant compte des spécificités des publications savantes et de leur circulation au sein de l’écosystème de la recherche scientifique. Elle mettra en lumière les continuités et les ajustements nécessaires pour penser la découvrabilité en science selon une approche holistique.
Le concept de découvrabilité suscite un intérêt croissant en raison des transformations engendrées par la numérisation et la plateformisation des milieux culturels et scientifiques. Pourtant, rares sont les travaux qui l’abordent sous un angle théorique. En examinant les dynamiques de découverte des productions éditoriales en ligne, ma thèse propose une conceptualisation approfondie de la découvrabilité. J’y soutiens qu’elle est un phénomène global (touchant toutes les composantes d’un milieu), transversal (couvrant divers aspects interdépendants) et structurant (pouvant transformer les pratiques et usages). Pour analyser cette dynamique, j’ai développé le modèle de l’«écosystème du livre», qui examine la découvrabilité sous trois dimensions interconnectées: les pressions régulatrices (les contraintes économiques, technologiques, politiques, socioculturelles façonnant le monde du livre); les cycles de vie du livre (les processus de production, distribution et consommation/réception); et la translation (une forme émergente de diffusion articulant la curation, la valorisation et la prescription des contenus). La présente communication explore la possibilité de transposer ce modèle au milieu universitaire, en tenant compte des spécificités des publications savantes et de leur circulation au sein de l’écosystème de la recherche scientifique. Elle mettra en lumière les continuités et les ajustements nécessaires pour penser la découvrabilité en science selon une approche holistique.
Dans le cadre d’une première étude, l’équipe a évalué l’exhaustivité et la précision des métadonnées linguistiques de la plateforme en vérifiant manuellement les langues d’un échantillon de 6 836 articles.
La recherche a démontré que près de 15 % des articles ne sont pas rédigés dans la langue déclarée par la plateforme. Ces inexactitudes conduiraient à une surestimation de la place de l’anglais et à une sous-estimation de celle d’autres langues comme le français, ce qui laisse croire que la diversité linguistique de la plateforme est encore plus grande qu’annoncé.
L’équipe a donc confirmé qu’il s’agit d’une initiative très importante pour surmonter les limites imposées par les bases de données traditionnelles, qui indexent principalement des contenus en anglais. À la base de différents outils de suivi, dont le Baromètre français de la science ouverte, OpenAlex pourrait également être un outil précieux pour effectuer des analyses complètes et représentatives des langues utilisées dans l’édition savante. Davantage de travail et de recherche seront cependant nécessaires pour garantir la qualité et l’exactitude des métadonnées, linguistiques et autres, qui s’y trouvent.
Qu’est-ce qu’une publication scientifique ? En quoi diffère-t-elle des autres types de publication ? À quoi cela sert-il de publier ? Est-ce que chaque type de publications se vaut ? Comment rédiger pour être lu·e ? Comment faire en sorte que ses publications soient facilement découvrables par la communauté scientifique et le grand public ? Quels sont les mythes persistants autour de la publication académique ?
En collaboration avec Vincent Larivière, notre membre Julie Francoeur prépare actuellement un guide destiné à toute personne qui débute en recherche. Ce guide présentera le cadre global de la publication scientifique et fournira au lecteur·trice des renseignements pratiques qui l’aideront à comprendre les rouages de la publication pour mieux évoluer dans le nouvel environnement qu’il intègre.
Objectif : Augmenter la littératie des personnes étudiantes aux deuxième et troisième cycles en matière de publication scientifique et de découvrabilité
Comment reconnaître un contenu scientifique ? Pourquoi faire confiance à une source plutôt qu’à une autre ? À la Chaire, nous proposons des ateliers grand public qui visent à fournir à toute personne intéressée des outils pour évaluer la fiabilité des contenus auxquels nous sommes continuellement exposé·e·s, notamment ceux disponibles en français, tout en encourageant une approche réflexive et nuancée.
D’une durée d’environ 1h30, ces ateliers sont ouverts à tout le monde, sans connaissances ni formations prérequises en philosophie des sciences ou dans une discipline scientifique.
Objectifs des ateliers :
- Développer un esprit critique face à des contenus présentés comme scientifiques ;
- identifier et comprendre les critères de fiabilité des contenus, notamment scientifiques ;
- apprendre à dialoguer conformément aux limites de nos propres connaissances ;
- explorer les raisons de notre adhésion à certaines croyances ;
- interroger la confiance que l’on accorde à une autorité, qu’elle soit scientifique ou non ;
- et découvrir la diversité des méthodes scientifiques et leur intérêt respectif selon les disciplines.
Les algorithmes de recherche d’information (RI) qui permettent de trouver des contenus dans un corpus déterminent en partie la découvrabilité d’un contenu.
Examiner les caractéristiques des algorithmes utilisés dans les outils de recherche spécialisés est donc la première étape essentielle à l’analyse des possibilités d’amélioration de la découvrabilité des contenus scientifiques francophones.
Le projet explore ensuite les aspects combinatoires des problèmes de RI pour proposer des approches efficaces qui favorisent la découverte de contenus francophones, en combinant RI multilingue et génération de contenus enrichie par RI.
Publications de la Chaire
Nous publions régulièrement les résultats de nos recherches sous différentes formes (brèves, articles, notes, chapitres, entretiens, etc.).
Lorem ipsum dolor sit amet. Rem reiciendis fuga est sapiente corporis est tenetur enim 33 nostrum autem non fuga tenetur ut Quis beatae? Eos animi harum et similique praesentium eos aliquid doloremque aut quam impedit sit enim deleniti et consequatur rerum. Qui veritatis voluptas et aliquid numquam non consequuntur accusamus. Ut vitae temporibus At rerum aspernatur et natus totam ea voluptas iure.
Qui ullam possimus eos impedit aliquid ut dolores voluptatum? Eum totam cupiditate non internos quia qui ipsam cumque cum quam sapiente ea eveniet cupiditate vel tempore ipsa aut enim sunt! Cum deserunt dolores nam pariatur cupiditate id blanditiis voluptate ut exercitationem debitis.
Id recusandae blanditiis vel eligendi eligendi aut error minus nam commodi minus ut deleniti voluptatem ab dignissimos officiis hic assumenda blanditiis. Ea suscipit deserunt sit vero dolorum id ipsum quis et omnis dolore qui explicabo culpa sit dolores porro. Est quae aspernatur ad amet minima et enim vitae ex itaque unde et consequatur quasi ut eligendi neque? Sit numquam repudiandae ut numquam impedit ut libero voluptas et laborum nulla et doloribus dolorem.
Publications des membres
Nous relayons les publications de nos membres lorsqu’elles touchent de près ou de loin à la découvrabilité des contenus savants en français.
Lorem ipsum dolor sit amet. Rem reiciendis fuga est sapiente corporis est tenetur enim 33 nostrum autem non fuga tenetur ut Quis beatae? Eos animi harum et similique praesentium eos aliquid doloremque aut quam impedit sit enim deleniti et consequatur rerum. Qui veritatis voluptas et aliquid numquam non consequuntur accusamus. Ut vitae temporibus At rerum aspernatur et natus totam ea voluptas iure.
Qui ullam possimus eos impedit aliquid ut dolores voluptatum? Eum totam cupiditate non internos quia qui ipsam cumque cum quam sapiente ea eveniet cupiditate vel tempore ipsa aut enim sunt! Cum deserunt dolores nam pariatur cupiditate id blanditiis voluptate ut exercitationem debitis.
Id recusandae blanditiis vel eligendi eligendi aut error minus nam commodi minus ut deleniti voluptatem ab dignissimos officiis hic assumenda blanditiis. Ea suscipit deserunt sit vero dolorum id ipsum quis et omnis dolore qui explicabo culpa sit dolores porro. Est quae aspernatur ad amet minima et enim vitae ex itaque unde et consequatur quasi ut eligendi neque? Sit numquam repudiandae ut numquam impedit ut libero voluptas et laborum nulla et doloribus dolorem.
Ressources
Bibliographie
Zotero
Nous mettons à disposition une bibliographie collaborative sur Zotero, une plateforme libre qui permet de d’indexer références bibliographiques. Vous y trouverez une sélection de ressources pertinentes liées à nos travaux.
Présentations
Colloque sur la découvrabilité — Acfas 2025
Présenté par Joanie Grenier — chercheuse doctorale à l’Université de Sherbrooke.
Le concept de découvrabilité suscite un intérêt croissant en raison des transformations engendrées par la numérisation et la plateformisation des milieux culturels et scientifiques. Pourtant, rares sont les travaux qui l’abordent sous un angle théorique. En examinant les dynamiques de découverte des productions éditoriales en ligne, ma thèse propose une conceptualisation approfondie de la découvrabilité. J’y soutiens qu’elle est un phénomène global (touchant toutes les composantes d’un milieu), transversal (couvrant divers aspects interdépendants) et structurant (pouvant transformer les pratiques et usages). Pour analyser cette dynamique, j’ai développé le modèle de l’«écosystème du livre», qui examine la découvrabilité sous trois dimensions interconnectées: les pressions régulatrices (les contraintes économiques, technologiques, politiques, socioculturelles façonnant le monde du livre); les cycles de vie du livre (les processus de production, distribution et consommation/réception); et la translation (une forme émergente de diffusion articulant la curation, la valorisation et la prescription des contenus). La présente communication explore la possibilité de transposer ce modèle au milieu universitaire, en tenant compte des spécificités des publications savantes et de leur circulation au sein de l’écosystème de la recherche scientifique. Elle mettra en lumière les continuités et les ajustements nécessaires pour penser la découvrabilité en science selon une approche holistique.
Présenté par Simon Van Bellen — Conseiller principal à la recherche chez Érudit.
Bien que la publication savante canadienne soit dominée par l’anglais, des milliers d’articles sont publiés en français chaque année au pays. Sur près de 1 000 revues canadiennes actives aujourd’hui, environ une centaine publient uniquement en français, autour de 350 permettent l’anglais et le français et une trentaine acceptent d’autres langues, en plus des deux langues officielles.
Nous présentons certaines caractéristiques des périodiques savants canadiens ainsi que de leurs contenus, notamment en ce qui a trait à la composition de l’autorat et aux thématiques de recherche. En nous basant sur l’analyse des tendances de consultation effectuée sur la plateforme Érudit, nous présentons également un aperçu du rayonnement de ces contenus auprès des lectorats canadiens et internationaux. La langue de publication est la variable principale expliquant l’origine du lectorat, et le français n’a rien à envier à l’anglais pour ce qui est des consultations répertoriées. Nous concluons que l’emploi du français permet d’atteindre un lectorat national francophone, et de faire rayonner les contenus bien au-delà des frontières canadiennes, tout autant que les publications en anglais
Présenté par Vincent Larivière et Émilie Paquin — Titulaire et coordonnatrice de la Chaire de recherche sur la découvrabilité des contenu scientifiques en français.
La découvrabilité ne peut être accrue ou favorisée que si le contenu à découvrir existe. Or les données dont nous disposons sont très claires : autour de 2 % des articles scientifiques, 6 % des monographies, 4,5 % des chapitres de livres et 5,8 % des thèses sont actuellement disponibles en français, pourtant cinquième langue parlée dans le monde. Face au déclin de l’usage du français — ainsi que de toutes les langues autres que l’anglais — dans la diffusion des résultats de la recherche, la question des facteurs qui conditionnent le choix de la langue de publication se pose de façon aiguë. Alors que la littérature sur le sujet nous indique que les critères d’évaluation des professeures et professeurs ainsi que de leurs activités de recherche sont en tête des facteurs qui influencent le plus la désaffection du français en science, une analyse de ces critères nous permet de voir que les chercheuses et chercheurs francophones basés au Québec sont loin d’être les victimes d’un système qui les exclut. Dans cette présentation, il s’agira d’illustrer le fonctionnement du système d’évaluation au Québec et de le comparer avec celui en place en France afin de réfléchir aux enjeux qui sous-tendent les approches québécoise et française d’évaluation de la recherche.
Présenté par Lucía Céspedes — conseillère à la recherche chez Érudit.
Le Web of Science (WoS) de Clarivate et Scopus d’Elsevier sont depuis des décennies les principales sources d’informations bibliométriques. Bien qu’elles soient très bien gérées, ces bases de données propriétaires et fermées sont largement orientées vers les publications en langue anglaise, ce qui conduit à une représentation insuffisante de l’utilisation d’autres langues dans la diffusion de la recherche. D’autres plateformes, souvent qualifiées d’« alternatives », fournissent quant à elles des informations de recherche complètes, inclusives et libres de droits. Cependant, elles présentent fréquemment des imprécisions dans les métadonnées et des problèmes d’indexation. Dans cette présentation, nous discutons du rôle des infrastructures telles que OpenAlex, OJS et DOAJ dans la promotion d’un écosystème de publications scientifiques réellement multilingue et diversifié.
Présenté par Julien Vallières — Archéologue.
En collaboration avec l’Acfas, nous avons produit une base de données à partir des publications et archives de l’association (imprimées et, pour les années plus récentes, numériques). Cette base est constituée d’un répertoire d’énoncés socioprofessionnels portant sur les scientifiques québécois et canadiens francophones. Ces énoncés concernent près d’un siècle d’activité scientifique. La base de données indexe (jusqu’à maintenant) 140 000 communications et recense 80 000 auteurs. Elle fournit des informations sur les domaines de la science auxquels ces auteurs contribuent et leurs objets de recherche. Elle les situe temporellement (leurs années d’activité), socialement (leurs collaborateurs, les collègues avec lesquels ils partagent la tribune, leurs rôles au congrès), professionnellement (leurs affiliations institutionnelles, leurs titres). Elle offre une vue d’une profondeur inédite sur la sociabilité savante au Québec et au Canada. Le pari d’exhaustivité, rendu possible par le numérique, promet de contribuer au renouveau de l’histoire des sciences et, plus largement, de l’histoire culturelle, en dévoilant des voix souvent oubliées, des relations interpersonnelles habituellement insaisissables et des zones sous-documentées de la vie culturelle québécoise.
Trois points de notre exposé : 1. Notre chaîne de traitement, à laquelle ont été intégrées les avancées de l’intelligence artificielle générative ; 2. Au regard de la mobilisation des connaissances, le recours aux mêmes avancées pour rédiger des notices biographiques ; 3. Comment nous envisageons la suite du développement de la base, en particulier son enrichissement.
Présenté par Carolina Pradier — Chercheuse doctorale à l’Université de Montréal.
La communauté scientifique latino-américaine a réalisé des progrès significatifs vers la parité hommes-femmes, avec une représentation presque égale des femmes et des hommes scientifiques. Néanmoins, les femmes continuent d’être sous-représentées dans la communication scientifique. Tout au long du XXe siècle, l’Amérique latine a établi son circuit universitaire, en se concentrant sur des sujets de recherche d’importance régionale. À travers une analyse des publications scientifiques, cet article explore la relation entre les inégalités de genre dans la science et l’intégration des chercheurs latino-américains dans les circuits académiques régionaux et mondiaux entre 1993 et 2022. Nous constatons que les femmes sont plus susceptibles de s’engager dans le circuit régional, tandis que les hommes sont plus actifs dans le circuit mondial. Cette tendance est attribuée à un alignement thématique entre les intérêts de recherche des femmes et les questions spécifiques à l’Amérique latine. En outre, nos résultats révèlent que les mécanismes contribuant aux différences entre les sexes en matière d’accumulation de capital symbolique varient d’un circuit à l’autre. Le travail des femmes obtient une reconnaissance égale ou supérieure à celle des hommes dans le circuit régional, mais suscite généralement moins d’attention dans le circuit mondial. Nos résultats suggèrent que les politiques visant à renforcer le circuit académique régional encourageraient les scientifiques à se pencher sur des sujets pertinents au niveau local tout en favorisant l’égalité des sexes dans les sciences.
Présenté par Eric Charton — Directeur de la recherche et du développement au Centre de recherche informatique de Montréal.
Dans le cadre de la Chaire de recherche du Québec sur la découvrabilité des contenus scientifiques en français, nous réfléchissons à l’influence de la langue sur un contenu scientifique. En particulier, nous cherchons à évaluer à quel point les différences qui peuvent exister d’une langue à une autre (par exemple, entre le français et l’anglais ou encore l’anglais et le chinois) peuvent rendre l’expression de résultats de recherche plus ou moins subtilement différents. On sait que les différences entre langues sont nombreuses : certains concepts existent dans une langue et pas dans une autre, les mots décrivant un objet peuvent être plus ou moins nombreux, plus ou moins spécifiques, les règles grammaticales radicalement différentes. Ces subtiles différences ne sont pas uniquement grammaticales, sémantiques et lexicales, elles peuvent aussi être culturelles : on pourrait par exemple se demander si l’usage du tu et du vous en français et du vouvoiement générique en anglais produisent un résultat différent dans un questionnaire. Dans cette présentation, nous dresserons un panorama de ce sujet d’étude et de l’état de l’art dans le domaine.
Présenté par Audrey Laplante — Professeure à l’Université de Montréal
Présenté par Marie-Jean Meurs — Professeure à l’Université du Québec à Montréal
Présenté par Philippe Langlais — Professeur à l’Université de Montréal.
L’intelligence artificielle (IA) ouvre de nouvelles perspectives pour l’enrichissement et l’accessibilité des contenus académiques en sciences humaines et sociales. Je présenterai le fruit d’une réflexion menée au sein d’Érudit visant à encadrer le passage raisonné à l’IA dans la plateforme. J’articulerai cette réflexion autour de deux axes—l’extraction des métadonnées d’un article et la consultation fluide des documents—qui tous les deux amènent leur lot d’opportunités, mais également de défis. J’avancerai l’idée qu’une intégration réussie de l’IA dans un environnement comme celui d’Érudit n’est pas tant un enjeu technologique qu’un enjeu d’évaluation.
Présenté par Samy Assouane — candidat à la maîtrise à l’Université du Québec à Montréal.
Nous présenterons un outil développé pour analyser la répartition des langues d’articles scientifiques et de monographies du Québec et de France, collectées sur diverses plateformes. Cet outil récupère automatiquement les métadonnées essentielles, telles que la langue de publication, l’année de publication, le domaine et le pays d’affiliation des autrices et auteurs, offrant ainsi une vue d’ensemble sur la diversité linguistique des productions scientifiques. Il révèle plus particulièrement l’évolution de la part des contenus scientifiques en français par rapport à d’autres langues, sans nécessiter d’expertise technique. Grâce à une interface conviviale, la personne utilisatrice peut obtenir des statistiques claires à travers différents diagrammes paramétrables, auxquels il est possible d’appliquer des filtres pour explorer en profondeur les tendances. La plateforme permet également d’afficher les données brutes sous forme de tableaux interactifs, facilitant l’examen direct des informations extraites des différentes sources.
Présenté par Susanna Fiorini — Coordonatrice scientifique, Operas.
Au cours de la dernière décennie, les outils de traduction et de rédaction basés sur l’intelligence artificielle (IA) ont ouvert la voie à de nouvelles opportunités pour favoriser le multilinguisme dans la communication savante. Depuis l’arrivée de la traduction automatique neuronale (TAN) en 2016 à l’avènement plus récent de l’IA générative (GenAI ou IAg), les recherches menées ont permis d’envisager des cas d’usage divers, tels que l’utilisation de la traduction automatique brute ou légèrement supervisée pour traduire les métadonnées et améliorer ainsi la découvrabilité des publications, le déploiement de la TAN comme aide à la rédaction et à la traduction pour les auteurs et les traducteurs, ou encore l’emploi de l’IA générative pour produire des textes multilingues ayant des finalités scientifiques variées. Lors de cette présentation, ces cas d’usage potentiels seront analysés sur la base de données quantitatives et qualitatives obtenues dans le cadre du projet Traductions et science ouverte afin de fournir un aperçu des performances des outils évalués. La discussion portera également sur les méthodes d’évaluation existantes et la mesure dans laquelle elles reflètent la complexité de la production de contenus multilingues dans la communication savante.
Présenté par Gabrielle Anctil — journaliste en résidence.
Les journalistes se trouvent tout au bout du processus scientifique, arrivant souvent une fois que l’article est paru pour en relayer les résultats au grand public. Malgré cette relation symbiotique, la communication est occasionnellement ardue. Pour les équipes de recherche, les rouages de la machine médiatique peuvent sembler impénétrables. Pour les journalistes, la quête d’intervenantes et d’intervenants ou l’accès aux publications relève parfois du miracle. Comment faciliter l’interaction entre ces deux mondes, pour contribuer à une meilleure découvrabilité de la science?
Présenté par Louise Germain — Directeur général de Wikimedia Canada et Michael David Miller — Bibliothécaire de l’Université McGill
Les projets Wikimédia ont un potentiel intéressant pour la découvrabilité des savoirs en ligne, notamment en recherche académique. Cette présentation explorera comment les projets Wikimédia pourraient contribuer à accroître la visibilité des contenus scientifiques, en particulier en français et au Québec. Dans cette présentation, nous aborderons les enjeux liés à la présence des savoirs québécois sur Wikipédia et les stratégies pour améliorer leur diffusion (notamment par Wikidata et les bases de données ouvertes) et nous discuterons des initiatives locales qui contribuent à renforcer la place du Québec dans l’écosystème numérique du savoir.
Présenté par Sophie Bretagnolle — Chercheuse doctorale à l’Université du Québec à Montréal
Face aux campagnes de désinformation, il nous semble souhaitable de favoriser la découvrabilité des contenus scientifiques. Cependant, comment chercher des contenus scientifiques si nous ne sommes pas en mesure de les reconnaître ? Pourquoi ces contenus seraient-ils plus fiables que d’autres ? Que faire lorsque des contenus sont contradictoires ou que des incertitudes sont mentionnées ? Afin d’explorer ces questions, notre projet de recherche vise à bâtir des ateliers grand public inspirés de travaux en philosophie des sciences permettant à toute personne intéressée de disposer d’outils pour évaluer la fiabilité des contenus auxquels nous sommes continuellement exposé·e·s, notamment ceux disponibles en français, tout en encourageant une approche réflexive et nuancée. D’une durée d’environ une heure et demie, ces ateliers seront ouverts à tout le monde, sans connaissances ni formations prérequises. Nous présenterons le projet et les étapes de validation en collaboration avec le public.
Télécharger la présentation
Glossaire
Développer un vocabulaire commun est une étape essentielle pour assurer la cohésion de nos efforts et réflexions.
Infrastructure qui agrège, indexe, diffuse et donne accès, depuis un point d’entrée centralisé, à de grandes masses de contenus numériques scientifiques.
Exemples : Google Scholar, Web of Science, OpenAlex.
Infrastructure d’entreposage et de diffusion des thèses et mémoires, des prépublications et autres.
Exemples : Archipel (UQAM), Papyrus (UdeM), Cognitio (UQTR), Savoirs (UdeS).
Les fonctionnalités de découverte concernent les interfaces des plateformes ou des agrégateurs.
Logiciel de recherche d’information (utilisé par les agrégateurs, les dépôts institutionnels et les plateformes)
Exemple: Google, Bing, DuckDuckGo, theses.fr.
Organisme et infrastructure qui produit, diffuse et assure l’indexation de contenus scientifiques, ainsi que leur préservation à long terme. La plateforme de diffusion interagit avec l’éditeur et gère divers aspects de la mise en ligne, notamment la gestion des droits.
Exemples : Érudit, Cairn, OpenEdition, HAL.
Actualités
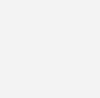
La science en français, ça sert à quoi?
Gabrielle Anctil, Magazine l'Acfas. 17 septembre 2025
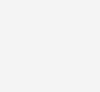
Le combat de la recherche univesitaire en français en contexte minoritaire.
Le balado de Fred Savard S7, EP3. Enregistré au congrès l'ACFAS.
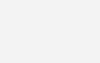
Debout pour la science!
La chaire adhère au mouvement international "Stand up for science".
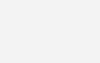
Science le grand effacement
Infographie résumant la conférence de Vincent Larivière, présentée au cœur des sciences.
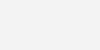
AI, Science and Society
Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, du 06 au 11 février 2025.
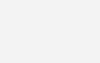
Ce qu’il faut savoir sur la mise à jour de la Politique sur le libre accès aux publications savantes de l’UdeM
Juliette Tirard-Collet, UdeMNouvelles, 23 octobre 2024.
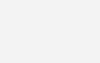
Vers une évaluation de la recherche plus ouverte et équitable : la déclaration de Barcelone
Olivier Pourret et Lonni Besançon, The Conversation, 23 octobre 2024.
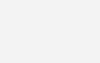
Découvrabilité du contenu francophone : le monde scientifique en réflexion
Martine Letarte, Affaires universitaire, 1er octobre 2024.
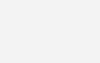
Des gestes concrets pour favoriser la science en français
Rémi Quirion, Le Devoir, 16 septembre 2024.
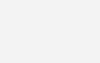
Libre accès : une mine de diamants sous ses pieds
Maxime Bilodeau, Affaires universitaires, 21 août 2024.
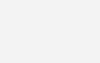
Mettre l’IA au service de la diversité culturelle
Claude Gauvreau, Actualités UQAM, 12 août 2024.
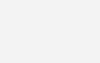
Dix millions de dollars pour des publications scientifiques en français plus accessibles
Virginie Soffer, UdeMNouvelles, 7 juin 2024.
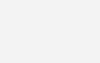
Une nouvelle chaire pour découvrir plus facilement des contenus scientifiques francophones
Virginie Soffer, UdeMNouvelles, 3 juin 2024.
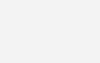
La France et le Québec nouent un partenariat sur la découvrabilité des contenus scientifiques francophones
Agence universitaire de la francophonie, AUF, 29 mai 2024.
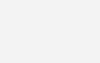
« Il y a urgence d’agir » pour la science et la culture en français
Chloé-Anne Touma, CScience, 22 mars 2024.
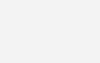
Scientifiques : l’avantage d’être né anglophone
Agence Science-Presse, Agence Science-Presse, 20 juillet 2023.
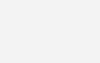
Peut-on encore faire de la science en français ?
Jean-Benoît Nadeau, L’actualité, 30 novembre 2022.
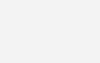
Facteur d’impact: l’UdeM signe la déclaration sur l’évaluation de la recherche
Béatrice St-Cyr-Leroux, UdeMNouvelles, 31 janvier 2022.
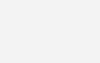
De l’importance du français en science
Marie Lambert-Chan, Québec Science, 13 mai 2021.